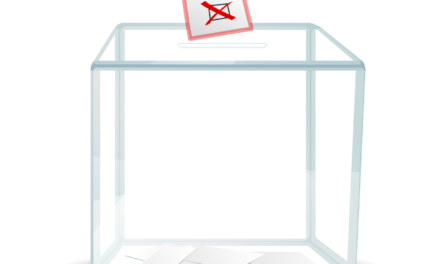Se passe-t-il encore quelque chose sur la planète aéro ?
Depuis quand n’a-t-on pas lancé d’appareil commercial réellement nouveau ?
Les Bureaux d’Etudes de la planète n’ont certes pas chômé, ces dernières années. Entre l’A321 XLR, le B737 MAX et le B777-X, les programmes de certification ne leur ont pas manqué. Mais depuis quand n’ont-ils plus mis une page vraiment blanche sur leur table à dessin ? Le 321 XLR n’est qu’une version allongée, remotorisée et survitaminée du vénérable 320. Le 737 MAX n’est lui-même qu’un 737 de plus, certifié sous le parapluie des « grandfather rights », et ce fut d’ailleurs là tout son problème. Sans doute, la cabine élargie et les ailes repliables du B777-X nous tiennent-ils en haleine depuis assez longtemps pour nous faire trouver de la nouveauté à ce programme. Peut-être même son coût a-t-il contribué à cette perception, mais sa fiche-produit et sa photo de profil suffisent à rétablir les choses. Et d’ailleurs, c’est un jeune premier aux cheveux déjà grisonnants qui entrera en service quand il le pourra, mais dont la présentation au public date du Salon de Dubaï de 2013.
Chez Airbus, il faut remonter à décembre 2006 et au 350 XWB pour retrouver les émotions des soirs de Première. Chez Comac, l’annonce du C919 remonte à 2010. Lancé en 2017, l’Embraer E2 n’était qu’un upgrade du formidable E-Jet. Du côté Russe, le MC21 d’Irkout date déjà de 2009.
Les plus anciens se souviennent avec nostalgie de l’effervescence de la première décennie 2000, où les catalogues de tous les avionneurs furent totalement refondus. Que s’est-il passé, depuis ? Quel est ce charme du château de la Belle au Bois Dormant, qui s’est abattu sur la construction aéronautique mondiale ? Ce métier est habitué aux cycles longs, et a déjà connu des pauses, mais les 14 années d’attente entre les lancements du Boeing 777 en 1990, et du 7E7 en 2004, ont été pulvérisées depuis. Ce ne sont pas les 777-X ou 747-8 qui feront illusion. Et du reste, la longue interruption qui précéda l’accouchement du 787 fut assez largement analysée comme une des principales causes de ses douleurs. Ne serait-il donc pas temps de se ressaisir ?
Cependant, rien ne semble pouvoir réveiller la planète aéro en 2023. Et il y à cela quelques excellentes raisons.
Les positions compétitives sont en effet figées comme elles peuvent l’être dans un métier dont le partage est acté. Comme si, bien ou mal, tout le monde avait appris à vivre dans des frontières tracées par les armes, et gravées par le temps. C’est un équilibre qu’il faudra une révolution pour rompre. Une révolution d’autant plus naturelle à attendre qu’elle est déjà en vue. Elle s’appelle l’avion vert. Le prochain appareil véritablement nouveau devra être vert. Il sera un pari d’ampleur comparable aux lancements du B707 en 1955, le premier jet commercial de l’histoire, ou du premier bimoteur géant, l’A300 d’Airbus en 1969.
Chacun a sa vision de ce que sera l’avion vert. Des visions pour le moins variées, en forme de prédictions se voulant plus ou moins autoréalisatrices, et tenant donc davantage du lobbying que de la divination. En dépit des tons très affirmatifs adoptés par les influenceurs de tous bords, la variété-même de leurs discours semble indiquer que la cause n’est pas entendue. « The jury is still out », dit-on en bon anglais. Et le jury a le droit de prolonger ses délibérations sur un pari de cette ampleur. La construction d’avions est une affaire de cycles longs.
NZ50, ou l’incontournable SAF…
Verdir l’aviation commerciale est une nécessité. Qu’on la considère sous l’angle de l’enjeu écologique, de l’acceptabilité sociétale, des coûts et de la disponibilité de l’énergie fossile, ou de l’exigence des Etats, la question ne se pose plus. Et ce, d’autant moins que cette activité peut se payer la transformation. Que faut-il entendre par là ? Que le client mettra la main à la poche, pour un service dont la valeur reste réelle et solvable. Le prix du billet gonflera sans doute. Il est possible qu’il cesse d’être accessible à tous ; mais tous les passagers du monde renonceront-ils donc à cet acquis ? L’industrie aéronautique renoncera-t-elle à satisfaire le marché solvable de ses clients les plus aisés, peut-être réduit en volume, mais pas nécessairement en dollars ? Non, voilà un scenario qui ne se produira pas. Plus vraisemblablement, les entreprises s’adapteront à une évolution de leur demande. Cette adaptation porte déjà un nom. Elle s’appelle NZ50, acronyme de Net Zero 2050.
L’objectif est affiché. Le transport aérien commercial sera donc neutre en carbone à l’horizon 2050. Et il est révélateur que dès cette annonce, la pression sociétale sur ce mode de transport, qu’on la nomme flygskam ou plane bashing, sembla avoir baissé de deux crans. En d’autres termes, l’objectif est globalement accepté par les parties prenantes. Pourquoi ? Parce que tout le monde comprend bien combien il est ambitieux. Il est toujours tentant de demander plus à un partenaire, mais que faire s’il ne le peut pas ? Exiger sa disparition ? Mais personne ne meurt sans combattre. L’autre option, d’espérer faire mieux ensemble qu’en ennemis, conduit à se faire confiance autour du mot d’ordre de NZ50.
Car de quoi s’agit-il, en chiffres ? De transformer une flotte de 25 000 appareils, dont la valeur brute totale, après remises, dépasse le millier de Milliards de dollars. Un tel chiffre donne le vertige. Aussi, faut-il commencer par en prendre la mesure. Que fait-on, avec une telle somme, comparable au budget annuel de l’Etat Français ? Par exemple, 5 millions de logements et de maisons. On bâtit une ville, avec autant d’argent. C’est donc une métropole, qu’il s’agit de remplacer. On a vu dans l’histoire des capitales prendre leur envol en un quart de siècle. En pensant à l’œuvre d’Haussmann, quelle confiance accorderions-nous à des bâtisseurs qui prétendraient aller beaucoup plus vite ?
Et une flotte d’avions n’est pas une ville comme les autres. Pour la refondre, il ne faudra pas compter sur tous les artisans de la terre, mais sur une paire d’avionneurs dont nous connaissons bien les capacités. Que pouvons-nous attendre d’eux, d’ici à 2050 ? Quelques années encore à évaluer les meilleures configurations d’appareils, suivies d’une décennie de développement et de certification, et d’une entrée en service commercial autour de 2035. Après quoi, il faudra produire, suivant une montée en cadence en S, timide au début, puis à pleine capacité. Sans doute parviendront-ils à produire 15 000 appareils entièrement nouveaux en 15 années. Ce sera un effort considérable, qui dans le passé, ne fut égalé qu’en temps de guerre, et ne révolutionnera pourtant que la moitié de la flotte mondiale d’ici la mi-temps de notre siècle. Si l’on ne peut donc attendre de notre industrie lancée à pleine vitesse que la moitié du travail de décarbonation, d’où viendra l’autre moitié ? Une seule solution existe, qui s’appelle le SAF, pour Sustainable Air Fuel.
Quelle est cette solution miracle ? Un kérozène des plus classiques, donc parfaitement compatible avec tous les appareils existants. Un kérozène, c’est-à-dire un produit carboné, mais dont la synthèse tire son carbone non pas du sol, mais de l’atmosphère elle-même. Le carbone que sa combustion rejettera dans l’atmosphère en aura donc été extrait au préalable. On aura en somme pris soin de nettoyer l’atmosphère avant de la souiller des mêmes quantités de déchets. C’est ainsi que par un artifice comptable bien trouvé, ce carbone-là pourra être qualifié de neutre. Sur le papier, c’est comme s’il n’existait pas. Il faudra bien entendu créer une industrie de production de ce fluide acceptable aux yeux de la règlementation, si ce n’est de la nature. Son coût ne pourra être inférieur à celui du kérozène fossile, mais s’il en va de l’avenir de l’aviation mondiale, il n’y aura pas à hésiter.
Voilà donc, à grosses mailles, à quoi ressemblera la flotte décarbonée du milieu de notre siècle. Une moitié d’appareils classiques, alimentés par un carburant dont la verdeur aura été négociée sur un tapis de la même couleur, et une autre moitié de machines révolutionnaires.
… et une révolution en forme d’arrêt sur image
Paradoxalement, le premier effet de la révolution décarbonée sera donc de figer la flotte mondiale dans un conservatisme de plus d’une décennie.
Le SAF est une illusion, qu’il faudra faire durer tant qu’il n’y aura rien pour la remplacer, mais qui ne doit pas nous tromper nous-mêmes. Si en effet, l’on croit vraiment que ce carbone n’a rien à faire dans notre atmosphère, alors il ne sera pas éternellement acceptable de l’y recracher après l’en avoir extrait. S’il est vraiment nécessaire de laver l’atmosphère de notre petite planète, ce ne sera pas pour la polluer aussitôt de la matière de ses anciennes taches. Une neutralité de pure convention ne sera pas une excuse pérenne. Le SAF aura son heure de gloire, parce qu’à court terme, il n’y a rien d’autre, mais cette heure ne durera pas toujours.
Le SAF ne sera donc tacitement acceptable que pendant la durée de sa mission, d’assurer la jonction entre les modèles des catalogues actuels, et leurs successeurs véritablement verts. Cette dérogation, tolérée parce que nécessaire, a une conséquence majeure : ni Airbus, ni Boeing n’ont plus le droit d’apporter à leurs catalogues aucun nouveau produit, qui manquerait à présenter toutes les garanties d’une authentique verdeur. C’est à cette lumière qu’il faut comprendre l’abandon par Boeing de son programme NMA (New Midsize Aircraft).
D’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, la Road Map Produit passe par un avion vert, mais nul ne sait exactement lequel réaliser. Plusieurs options ont été suggérées, mais sans qu’aucune se soit démarquée nettement. S’il est devenu évident qu’aucun appareil classique ne pourra plus être lancé, accepté, et encore moins amorti sur une durée suffisante, cela n’implique pas qu’une certitude se soit dégagée quant à la formule de remplacement. Prenons donc dès maintenant l’habitude d’un paysage passablement inanimé, auquel les avionneurs ne pourront insuffler un semblant de vie qu’au moyen de modifications incrémentales de leurs modèles actuels. Ils continueront à les faire voler, tant qu’ils ne sauront pas par quoi les substituer, et prolongeront donc l’intermède du SAF, aussi longtemps que la lumière ne sera pas faite sur le mystère de l’avion vert.
C’est ainsi que notre industrie est entrée dans une glaciation dont le début de dégel se joue à l’échelle des années, et la libération, du quart de siècle.
Ce dont on est sûr…
En un quart de siècle, beaucoup de choses peuvent se passer. Et deviner à quoi ressemblera le ciel à cette échéance est une gageure. Il est clair qu’à une telle échelle, quelques années de réflexion supplémentaire ne changeront pas grand-chose à l’histoire de notre atmosphère, et peuvent faire toute la différence entre l’échec et le succès. Une telle attente ne sera donc pas évitée. Cependant, tout n’est pas flou dans le décor de la pièce qui se prépare. Un certain nombre de faits s’y lisent déjà distinctement. Quelles sont ces certitudes, sur lesquelles bâtir un début de réflexion ? De quoi sommes-nous sûrs ?
- Rien ne se passera dans le segment des gros porteurs. Plusieurs raisons à cela :
- Economique : Les appareils de ce segment sont les plus récents des catalogues des avionneurs, et très loin d’être amortis.
- Ecologique : Du fait de leur usage majoritaire en Long-Courriers, et de l’efficacité intrinsèque qui découle de cet emploi où les décollages sont moins fréquents, ces appareils sont déjà deux fois plus performants en matière de rejets de carbone que les Moyens-Porteurs et Moyen-Courriers (100 gr/pax*km contre 180). Ils ne sont donc pas les candidats prioritaires au remplacement.
- Technique : Dans le monde du transport aérien, les innovations viennent par les petits modules. Dans le cas présent, il ne s’agira pas seulement de rénover les technologies, mais aussi leurs règles de certification. Il serait inimaginable de se lancer dans une telle aventure à bord d’un Gros-Porteur.
- Par voie de conséquence, et pour les mêmes raisons, le premier avion vert sera un petit module. La première priorité sera de remplacer le B737, puis l’A320, une fois les plâtres essuyés par le concurrent. Cet effort des deux avionneurs et de leurs autorités règlementaires les occupera pendant une décennie. Il faut donc envisager un scenario NZ50 à base de Gros-Porteurs inchangés, alimentés en SAF, et de Court-Courriers véritablement verts. Ce scenario est crédible, et comme il n’en existe pas vraiment d’autre, le transport aérien commercial aura donc le choix entre l’adopter ou renoncer à NZ50. Cette dernière option n’étant pas la plus facile à vendre au marché.
- Entre toutes les technologies envisageables pour ce petit avion vert, une seule prévaudra. Les Compagnies Aériennes, qui en majorité opèrent des flottes mixtes, n’en accueilleront pas deux différentes pour résoudre le même problème. Pour un opérateur, chaque innovation se traduit par de nouveaux moyens, de nouvelles formations et de nouveaux risques, alloués à très peu de vols à l’entrée en service. Pourquoi doublerait-il la charge qu’il peut ne porter qu’une seule fois ? Quels que soient les mérites d’une seconde technologie à se présenter sur le marché, elle serait incapable de franchir cette barrière. C’est ainsi que le premier avionneur à annoncer son choix pliera le match entre les technologies. Qu’il se contente de réussir son appareil, et le suivant devra s’aligner.
… ce qui en découle…
Voilà pour les certitudes. Avant d’entrer dans les spéculations technologiques, intéressons-nous aux conséquences d’un scenario NZ50 bâti sur un trafic Long-Courrier à base d’appareils existants alimentés en SAF, et un trafic Court-Courrier à base d’appareils nouveaux et réellement verts.
- Un appareil nouveau et réellement vert ne sera pas seulement plus petit que les Moyen-Courriers traditionnels. Il affichera également une moindre autonomie. Qu’il soit alimenté par une batterie, dont l’énergie massique peine encore à tenir les objectifs d’une performance acceptable, ou par un réservoir d’hydrogène qui, même sous une pression de 700 bars, est au mieux 4 fois plus volumineux que son équivalent classique, il ne pourra afficher un rayon d’action à plusieurs milliers de Nm.
- Le successeur du B737 (appelons-le ici B797 pour les commodités du langage) ne sera donc pas un appareil aux performances identiques. Sans doute faut-il l’attendre dans la gamme 100 pax * 1000 Nm, pas très éloignée du domaine de l’aviation régionale. Et peut-être ne faut-il pas chercher plus loin les causes de l’abandon inattendu, et toujours inexpliqué, de l’alliance avec Embraer. L’avion de la Reconquista pouvait difficilement être assemblé à San Jose dos Campos.
- Le remplacement des monocouloirs traditionnels par des modules plus courts en taille et en portée transformera donc en profondeur le réseau du transport continental.
- Or le transport continental sert aussi bien à assurer la mobilité locale, qu’à alimenter les Long-Courriers. Tous les passagers du monde payeront donc leur tribut à une aviation locale totalement décarbonée. Non seulement en prix du billet, mais aussi et surtout en multiplication des vols. Le passager qui va aujourd’hui de Limoges à Buffalo en 3 vols et 2 changements à Paris et NYC pourrait bien avoir à envisager des voyages de 4, voire 5 legs. Il ne faut pas imaginer une aviation révolutionnée en tout, à l’exception de l’expérience offerte au passager. Lui aussi devra contribuer, et il peut très bien l’accepter, en échange d’une amélioration des modalités de son passage par les aéroports. En effet, beaucoup de confort peut être conquis sur ce segment du voyage où la médiocrité est encore la norme. Il ne s’agit pas là de paris spectaculaires, ni de dépenses pharaoniques. Simplement d’exploiter tout le potentiel de fluidité des transits offert par le numérique, et de proximité de la desserte, offert par un réseau déjà dense de 460 aéroports en France, et 15 000 aux USA. Certes, tous ces champs d’aviation référencés par worldstat n’ont pas vocation à devenir demain des hubs internationaux, mais leur réserve foncière existe. Elle est déjà disponible, et c’est l’essentiel. Il suffira, pour l’exploiter, de s’intéresser aux low-hanging fruits de ce moment du voyage qui se passe au sol, avec le soutien de Régions trop heureuses de se connecter aussi facilement à un dispositif mondial.
- De plus petits appareils pour faire le même travail à partir de distances élémentaires plus courtes, cela veut dire beaucoup plus de trafic, de personnels navigants, et de contrôles au sol. Une telle expansion, couplée à une charge de travail accrue par la sophistication de trajectoires de vol mieux optimisées, posera en des termes nouveaux la question de la taille de l’équipage technique. Faudra-t-il revenir à l’équipage à 3, ou bien tirer parti des technologies numériques et redéfinir le partage des tâches entre l’homme et la machine, pour viser enfin le pilote unique ? Poser la question, c’est avoir la réponse.
- Une densification du réseau de desserte locale, cela veut dire une multiplication des stations-service spécialisées dans les nouvelles technologies, quelles qu’elles soient, que cet appareil vert mettra en œuvre. Si nous parlons d’hydrogène, il faudra en distribuer en plusieurs milliers de points de la planète, dès l’entrée en service de l’appareil. Si nous parlons de batteries, il faudra les recharger en plusieurs milliers de points.
… et ce qui reste à deviner
Quelle technologie ? Quel délai ? Quel acteur tirera le premier ? Voilà les 3 questions, étroitement liées, qui restent en suspens.
Ces choix peuvent encore être différés de quelques années. Le temps que la poussière retombe sur le champ de la bataille technologique. Le pari est immense. Sans doute le plus lourd depuis le lancement du B707. Et davantage encore, puisqu’il ne s’agit plus cette fois de créer une nouvelle industrie mondiale, mais de la transformer du tout au tout, sans dégrader les niveaux de performance et de sécurité auxquels elle s’est habituée. Nous parlons ici d’une réforme complète des technologies et des modèles économiques, avec l’exigence d’une maîtrise parfaite de l’architecture de l’appareil, de ses données d’exploitation, de ses délais de réalisation, de sa sûreté, et de son marché. On comprend que pour lancer un tel coup de dés, demain soit un meilleur jour qu’aujourd’hui.
Cependant, le temps ne pèse pas le même poids pour tous les joueurs de la partie.
Sur le papier, Boeing a toutes les raisons d’être le plus pressé. Après le fiasco de l’entrée en service du 737 MAX, l’avionneur de Seattle était en détresse sur tous les segments de son marché. Moyen-Courrier interdit de vol, production chaotique du 787, certification arlésienne du 777-X, rentabilité en berne. C’était une de ces situations dont on sort en lançant un nouveau produit, mais avec cette fois deux sérieux obstacles en travers de son chemin : une innovation technologique majeure, et la perte de la confiance des autorités chargées de la certifier. Comment mettre en chantier un appareil révolutionnaire, de concert avec sa doctrine de certification, dans le climat de défiance qui s’était établi entre l’avionneur et la FAA ? Le coupable et son complice malgré-soi n’eurent donc d’autre option que d’attendre le retour à la normale avec, pour première étape, la reprise des vols de l’avion dont le seul nom était devenu une insulte à leurs oreilles. A partir de maintenant, il faudra surveiller très attentivement les prises de commandes de 737 MAX. Si contre toute attente, cet appareil parvenait à retrouver sa place sur le même podium que l’A320, l’étau se desserrerait enfin, et Boeing pourrait attendre. Dans le cas contraire, l’avionneur américain sera contraint de bouger, et le fera donc avec les technologies dont il peut disposer aujourd’hui.
Or où en étions-nous à la fin 2022 ? Le compteur des commandes brutes totalisait 561 B737 MAX après une première année de reprise des ventes, contre 888 A320. Cela reste un mauvais chiffre, mais difficile à interpréter, car influencé à la baisse par une queue de crise, et à la hausse par une bouffée de rattrapage. Le chiffre de 2023 sera donc décisif. Une deuxième année à deux tiers du score d’Airbus serait un signal clair.
Derrière cette question, dont la réponse ne saurait plus tarder, s’en profile une autre, moins facile à évacuer : celle de l’éternel dilemme entre la prime au premier entrant, et l’attente de la maturation technologique. On l’a en effet vu plus haut, au chapitre des évidences, le premier à tirer pliera le match des technologies au profit de sa préférée. C’est là un avantage considérable, mais dont l’attrait sera pondéré par un effet adverse, d’ampleur comparable : l’aéronautique commerciale est une longue histoire de primes au suiveur. Le concurrent qui mène la course offre à son adversaire un banc d’essai en grandeur réelle de toutes les idées à la mode. Il prend le vent, en laissant à l’autre le privilège de faire son tri entre les bonnes et les mauvaises. En cela, leur course ressemble à ces duels de cyclistes, où chacun cherche à sucer la roue de l’autre le plus longtemps possible, pour le déborder au dernier moment. Les habitués des parquets goûtent en connaisseurs le spectacle de ces coureurs immobiles, restant figés aussi longtemps qu’ils peuvent rester en équilibre après le signal du départ. Le meilleur avion en carbone n’est pas le 787, mais le 350, lancé deux années plus tard. Et cet enseignement prend un poids multiplié, à la veille d’une aventure cent fois plus révolutionnaire.
Pendant ce round d’observation où tout est patience, équilibre, maîtrise des nerfs, et désinformation de l’adversaire, ne doutons pas que seront réévaluées jusqu’au dernier moment les promesses des deux grandes technologies de stockage de l’énergie : l’hydrogène ou la batterie.
Du côté de l’hydrogène
L’hydrogène a été présenté en Europe comme la dernière bonne idée à avoir. Et il est vrai que cette solution présente quelques mérites. La technologie est parfaitement mature. Depuis des décennies, les lanceurs spatiaux maîtrisent le stockage de ce fluide en grandes quantités. Les piles à combustible chargées de le convertir en énergie électrique ont été mises au point pour le programme Apollo. Il est même possible de faire tourner des moteurs thermiques dont le fuel est l’hydrogène. Par ailleurs, il existe déjà une filière de production, pour les applications industrielles de cet élément.
Cependant, les atouts de cette solution en mesurent aussi les limitations.
En premier lieu, il y a peu de progrès à attendre de technologies éprouvées. Le volume théorique de stockage du fluide plus léger de la classification périodique de Mendeleïev est 4 fois celui du kérozène, et le restera jusqu’à la fin des temps. Et le volume réel sera longtemps bien supérieur, car pour stocker à 700 bars, il n’y a que les formes cylindriques qui tiennent. Plus question, sous de telles pressions, de glisser quelques litres de plus dans un dernier recoin oublié aux contours saugrenus, dans les ailes ou le fuselage de l’appareil. Ce déficit de densité aura des conséquences durables sur sa performance aérodynamique, l’exploitation de ses volumes intérieurs, et au bout du compte, son autonomie.
En second lieu, il faut se demander quoi attendre de la filière existante de production d’hydrogène. Dans quelle mesure celle-ci est-elle adaptée aux besoins de l’aviation commerciale ?
- En capacité mondiale, elle produit tous les ans 60 Millions de tonnes qui, en équivalence d’énergie, couvriraient à peine les besoins du seul segment des monocouloirs.
- En qualité écologique, son mode de production, par craquage de méthane à 96%, pourrait difficilement lui valoir un award de l’industrie verte.
- En déploiement logistique, son réseau de distribution est construit autour de quelques consommateurs industriels relativement concentrés. Tout le contraire d’un réseau de plusieurs milliers d’aéroports, aussi dispersés que possible à la surface de la planète.
C’est donc une infrastructure nouvelle, qui devra être créée pour les besoins de la mobilité verte. Créer une nouvelle infrastructure n’est pas un problème en soi. On comprend bien que l’aviation ne se décarbonera pas sans un minimum d’efforts. Mais pour financer ces efforts, il faudrait au moins pouvoir dire quelle performance économique est visée. Or le coût d’usage de toute infrastructure nouvelle dépend essentiellement du volume de sa production. Et à part l’aviation ou l’industrie traditionnelle, dans des quantités que nous avons vues marginales pour cette dernière, quels sont les autres utilisateurs potentiels d’hydrogène vert ? L’automobile, et c’est tout. Avec sa flotte mondiale de 1,5 Milliards de véhicules, l’automobile n’est pas l’autre grand consommateur. Elle est LE grand consommateur. Les navires de commerce sont des géants, mais en nombre trop limité pour que leurs besoins globaux pèsent dans la balance. Les trains modernes ne transportent pas leur énergie. A côté de ces prospects anecdotiques, les besoins de l’automobile sont potentiellement dix fois supérieurs à ceux de l’aviation commerciale. De sorte que du point de vue des coûts opérationnels d’un avion à hydrogène, il ne sera pas du tout indifférent, que l’automobile fasse à l’échelle mondiale le pari de cette technologie, ou ne le fasse pas.
C’est-à-dire qu’il sera impossible de connaître la performance économique réelle d’un avion à hydrogène tant que la question de l’automobile ne sera pas tranchée. C’est-à-dire que pour pouvoir vendre, et surtout acheter aujourd’hui un avion à hydrogène, il faudrait estimer viable sa performance économique, même sans le soutien de la filière automobile, puisque celui-ci n’est pas encore garanti. Il faudrait donc que le segment des monocouloirs justifie à lui seul le développement d’une infrastructure d’approvisionnement mondiale, autonome, et dispersée à l’extrême. Tant que cette équation économique n’est pas résolue, la filière aéronautique devra attendre pour se décider que l’automobile ait pris un parti. Or au stade actuel, le moins que l’on puisse dire est qu’elle en est très loin. Rappelons, pour nous en convaincre, les termes de l’équation. Le coût de production d’hydrogène vert en petites quantités s’établit aujourd’hui autour de $10/kg, alors que le modèle économique à viser compte sur des chiffres comparables à ceux du craquage de méthane, autour de $1/kg. En substance, la performance économique d’un avion à hydrogène dépend essentiellement de décisions qui seront prise à une date inconnue, en dehors de la filière aéronautique et de son contrôle. Difficile de lancer un programme sur des bases aussi mouvantes.
Accessoirement, l’inventaire des dommages climatiques créés par l’aviation commerciale ne se limite pas à la seule ligne des rejets de carbone. Les effets CO2 sont les plus faciles à appréhender, et c’est pourquoi l’attention se tourne naturellement vers eux, mais il n’est pas certain qu’ils soient les plus importants. Le référentiel climat de l’ISAE, dont il faut saluer la qualité, chiffre les effets non-CO2 de l’aviation au double de ses effets CO2, avec un poids de 86% pour les cirrus induits par les traînées de condensation. Il convient ici de se rappeler que la vapeur d’eau est aussi un gaz à effet de serre, au même titre que le CO2. Cette considération ne doit pas être un prétexte à l’inaction, mais une invitation à l’étude, car il est aussi précisé que les effets non-CO2 sont bien plus incertains que les effets CO2. Il faudra donc mieux les comprendre, avant de tout mettre dans le développement d’une machine à remplacer le carbone par ces longues trainées blanches dans le ciel, dont on risquerait de réaliser en chemin qu’elles sont pires que le mal.
Donc, tant du point de vue de l’environnement économique, que des enjeux climatiques globaux, la décision de lancer un avion commercial à hydrogène semble difficile à court terme. Ce n’est pas que cette solution soit à coup sûr mauvaise. Ce n’est même pas qu’elle présente trop de difficultés techniques. Mais elle requiert des clarifications qui ne seront pas disponibles à court terme. C’est ce flou qui la rend incompatible avec un lancement rapide de l’avion vert, par exemple par un Boeing acculé. Paradoxalement, c’est l’urgence à agir, qui aurait pour premier effet de condamner l’option hydrogène.
Les autres solutions de stockage
L’idéal serait de stocker dans une bonne batterie toute l’énergie nécessaire à un vol. Il suffirait alors de disposer de rechanges et/ou de capacités de recharge dans chaque aéroport du monde, et le tour serait joué.
Hélas, la masse des batteries capables d’assurer cette mission dépasserait aujourd’hui celle des bons vieux réservoirs de kérozène dans un facteur 60. Ce qui est beaucoup. Les performances des batteries évoluent, mais pas au rythme de la loi de Moore. La chimie n’est pas l’électronique. L’une joue avec des ions, et l’autre avec des électrons, considérablement plus légers. Cependant, il y a encore un facteur à gagner sur ce terrain, dont il serait d’autant plus sot de se priver, que les développements seront financés par d’autres filières industrielles.
En fait, il y a plusieurs terrains sur lesquels des facteurs importants peuvent être gagnés :
- La capacité des batteries. On l’a vu, tout ne viendra pas de ce terrain-là, mais il est sans doute possible de viser à terme un facteur 2. Peut-être même un peu mieux.
- L’autonomie. En ne cherchant pas à franchir les 6000km d’un A320, mais une distance 3 fois moindre, on gagne un facteur 3 sans grands risque ni effort.
- L’architecture de l’appareil. L’architecture classique (ie : Un cylindre surplombant deux ailes surplombant deux moteurs) est à bout de souffle. Il faut prendre conscience des difformités qui se sont accumulées sur ce modèle, entièrement dessiné autour de moteurs dont les diamètres n’ont cessé de s’accroitre dans leur course au rapport de mélange. Entraîner des soufflantes non plus par un arbre mécanique, mais par une alimentation électrique, permettrait ainsi d’en redéfinir le nombre, la répartition sur l’aéronef, la vitesse de rotation, et même le schéma de redondance. La géométrie de l’avion en serait libérée, ainsi que sa performance massique et aérodynamique. Cela conduirait à dessiner des formes révolutionnaires ? Certes, mais ce sont les révolutionnaires qui font les révolutions, et ceux-ci ne reculent pas devant l’objectif de gagner encore un facteur 2.
- D’où viendrait le reste du gain ? De plusieurs sources, comme d’habitude. L’efficacité des transports électriques est encore très médiocre sur un appareil classique. Elle pourrait être doublée par l’aménagement des géométries ou, pourquoi pas, par l’emploi de supraconducteurs. Les trajectoires dans le ciel peuvent aussi être lissées. Va-t-on continuer à tracer sa route à la règle-rapporteur de l’amiral Jean Cras, modèle 1917, comme au temps où l’énergie n’était pas un sujet ? Ne disposons-nous pas, au 21ème siècle, de capacités de calcul permettant de faire un peu mieux ?
L’avion à batteries n’est donc pas une option complètement folle, mais qui souffre tout de même d’un gros handicap : il compte sur la batterie de demain, alors que nous en avons besoin aujourd’hui. Même si elles ne suivent pas la loi de Moore, des améliorations sont néanmoins possibles dans le domaine du stockage. De sorte que l’avion à batteries de demain sera toujours meilleur que celui d’aujourd’hui. Et ceci sera une excellente raison pour le clouer définitivement au sol.
Et c’est là que le mot d’hybridation apparaît dans la conversation.
Un avion n’est pas hybride comme une voiture. Son hybridation vise un autre objectif. C’est un appareil dessiné autour de propulseurs entièrement électriques, eux-mêmes alimentés par deux sources, à base de batteries ou d’unités de puissance thermiques traditionnelles (alimentées au SAF, comme il se doit). L’hybridation est donc ici une simple duplication des sources d’électricité. Pourquoi ce luxe, à bord d’une machine dont on cherche à tout prix à réduire la masse ? Parce que d’une part, les deux présentent des caractéristiques différentes, dont on a besoin en fonction des régimes de vol. Le décollage est un coup de reins violent et bref. Le vol en palier, une poussée souple et longue. Cette première idée permet d’optimiser l’architecture de l’appareil ; mais pour le verdir tout à fait, il faut la seconde, qui est de changer ses batteries avec l’évolution de leurs performances massiques. C’est ainsi qu’en début de vie, le même appareil pourrait compter davantage sur l’énergie électrique produite par ses machines thermiques, et en fin de vie, sur ses batteries dernier cri. Une telle hybridation permettrait de ne compter que sur une partie des avantages de la nouvelle architecture en début de vie, et d’en améliorer la performance écologique progressivement, avec l’amélioration des procédés de stockage. La beauté de cette conception est de réaliser la transition écologique à bord d’un même appareil, sous le même Type Certificate. Ainsi devient-il possible d’amortir sur 30 années une machine dont la performance suit à toute heure les meilleurs standards technologiques en matière de batteries.
L’avion hybride, et c’est là son plus grand mérite, est certes très nouveau par ses formes, mais ne compte que sur des technologies disponibles aujourd’hui. Il peut donc être lancé aujourd’hui.
Qui a intérêt à quoi ?
Il est grisant de méditer sur les appareils de demain, mais en n’oubliant pas que pour que nous les voyions un jour, il faudra que ceux sur qui on compte pour les construire y aient intérêt. D’où la question, traitée ici de façon forcément trop sommaire : qui a intérêt à quoi ?
- Boeing a intérêt à sortir par le haut de sa nasse, et peut espérer le faire au moyen du lancement d’un nouvel appareil, nécessairement vert. Si le 737 MAX ne reprend pas pied rapidement, Boeing aura intérêt à ne pas trop tarder, soit au moyen d’un dernier avatar classico-futuriste de type TTBW (Transonic Truss-Braced Wing), soit d’un véritable avion vert, qui ne pourra alors être qu’hybride.
- Airbus a intérêt à tirer le meilleur bénéfice de sa position de force actuelle, basée sur un meilleur catalogue dans tous les segments du marché. Cela ne durera peut-être pas. Nous verrons ce que vaudra le 777-X. Mais pour l’heure, l’intérêt d’Airbus est de laisser Boeing s’enliser et tirer le premier, pour observer ses inévitables erreurs, et en tirer toutes les leçons. Ce faisant, Airbus devra renoncer au privilège d’imposer sa technologie, mais on l’a vu, ce privilège est loin d’être dépourvu de pièges.
- Les motoristes ont intérêt à favoriser la solution qui perturbera le moins le business model « rasoir et lames » de leurs moteurs. Il est à noter que les motoristes sont aujourd’hui les maîtres de la chaîne équipementière, dont les avionneurs ont besoin pour concevoir leur prochain appareil. L’avion vert ne se fera donc pas sans eux, et encore moins, contre eux. De ce point de vue, l’avion hybride constitue sans doute une solution plus réaliste, car plus sûre pour eux, à condition de garder la maîtrise de l’ensemble du système de propulsion et de génération électrique. Ce qui ne devrait pas être hors de leur portée.
- Les avionneurs auraient évidemment l’intérêt inverse, de retrouver, à la faveur d’une révolution technologique, un peu d’autorité sur les moteurs de leurs appareils, mais il est douteux qu’ils soient encore en capacité de faire valoir une telle revendication.
- Les Compagnies aériennes ont intérêt à une transition douce et économiquement soutenable, y compris pour les plus petites, limitant les paris sur d’éventuelles décisions d’autres filières industrielles. Elles souhaiteront également qu’une technologie unique leur soit proposée pour la décarbonation de leurs flottes. De ce point de vue, elles devraient avoir plus de facilités à adopter un appareil hybride.
N’oublions pas Comac
Quel candidat voyons-nous prendre la corde, à l’issue de ce rapide survol ?
Un appareil hybride de 100 pax, 1000Nm, à pilote unique, lancé par Boeing dans un nombre d’années se comptant sur les doigts d’une main. La seule véritable contrainte calendaire à un tel lancement étant le besoin, pour la FAA, d’avoir retrouvé assez de confiance et d’autorité pour le certifier.
Un tel appareil nous oblige à porter le regard au-delà des frontières traditionnelles de notre industrie. Car voilà : cet appareil est aussi le candidat préféré de Comac.
- Comac sait développer et certifier un appareil de cette taille, grâce à l’expérience acquise avec l’ARJ21 et le C919.
- Comac dispose d’un marché intérieur suffisant pour prendre le risque d’un tel développement.
- Comac dispose également de la complicité de son Régulateur.
- Comac peut accéder à toutes les technologies d’hybridation, de stockage électrique et de batteries, développées pour l’industrie automobile chinoise.
- Enfin, Comac a le désir et le soutien public pour devenir le véritable 3ème avionneur mondial.
Olivier Zarrouati, Thélème
Le 11 avril 2023